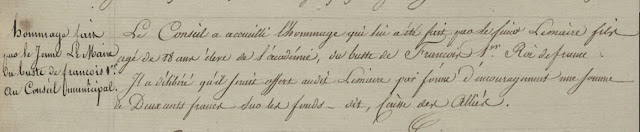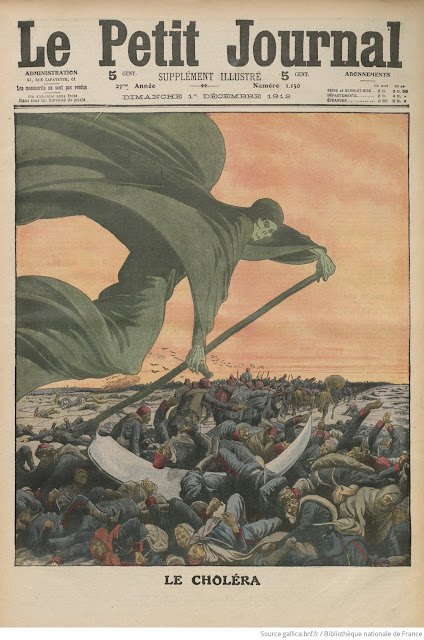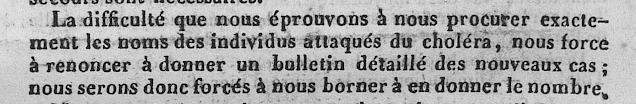« Relater la vie de Jean Froissart, c’est entreprendre de longs voyages à travers l’Europe occidentale du XIVe siècle. » Ainsi s’exprime Jean Trotin, auteur d’un intéressant article intitulé « Vie et œuvre de Jean Froissart » paru en décembre 1989 dans la revue Valentiana, une phrase qu’il place en ouverture de son propos. Et ces “longs voyages“ ne sont pas une métaphore : Froissart, au fil des ans, a effectivement parcouru des centaines de kilomètres, à une époque – le Moyen Age – où voyager n’était vraiment pas une partie de plaisir.

Sur cette carte contemporaine j'ai tracé les voyages de Froissart "en France",
et j'ai posé en regard la carte du royaume de France à l'époque de l'écrivain
Chacun sait que Froissart était né à Valenciennes, vers l’an 1337. Son premier protecteur fut Jean de Hainaut, frère de notre comte Guillaume, qui avait guerroyé en Ecosse et en France aux côtés du roi d’Angleterre Edouard III avant de retourner sa veste en 1345 et de choisir le camp français.

Jean de Hainaut (1288-1356) par Jacques de Boucq
(image extraite de Wikipedia)
Pourquoi protecteur ? Parce que quelqu’un comme Froissart, qui veut vivre de ses écrits, doit se faire “adopter“ par un noble et fréquenter sa cour, sa mission étant de charmer son auditoire par ses créations littéraires. Froissart fut en effet d’abord connu pour ses dons poétiques, et non pour son travail de chroniqueur.
Philippa de Hainaut (fille de notre comte Guillaume, donc nièce de Jean de Hainaut, et épouse du roi Edouard III) reçut Froissart à sa cour en 1362. « Il fut admis, écrit Jean Trotin, parmi les clercs de la chambre de la reine, charge qui faisait de lui un secrétaire et même un poète officiel. » La reine était friande de poésie courtoise, Froissart lui dédia quantité d’œuvres rimées.

En 1362 Froissart séjourne à Windsor, Westminster et Eltham, résidences royales, et à Berkhampstead, résidence du Prince de Galles, toutes localités proches de Londres
Oui, comment voyageait-on au Moyen Age ? Pour 95 % de la population, tout simplement à pied. La marche est le premier mode de déplacement médiéval, même pour de très longues distances. Pas de carrosses, pas de diligences, et les chariots sont réservés au transport des marchandises. Reste le voyage à cheval, adopté surtout par les aristocrates et les gens qui “ont les moyens“.

Au Moyen Age, on voyage à pied ou à cheval
(image extraite de Nota Bene sur Youtube)
On ne voyage donc que si on a une bonne raison de le faire, et après avoir rédigé son testament tant l’aventure est dangereuse. Pour ce qui concerne Froissart, Jean Trotin précise qu’il parcourait en moyenne quarante kilomètres par jour, à cheval donc, « ce qui suppose une heureuse constitution » — d’ailleurs selon ses contemporains, ajoute-t-il, Froissart avait un bon coup de fourchette. Les routes ne sont pas telles que nous les connaissons, ce sont plutôt des sentiers qui relient une localité à une autre, ou des chemins qui permettent le passage d’une charrette ; ils sont mal entretenus et « infestés de criminels », notamment les voies qui traversent les forêts, propices aux embuscades. Par ailleurs, lorsqu’il pleut, non seulement ni votre cheval ni vos pieds ne vous protègent de la pluie, mais les chemins deviennent boueux, glissants, parfois bloqués par des débordements de rivières. Or vous n’avez pas de carte pour trouver un “itinéraire bis“.
Jean Trotin précise encore : « Grâce aux lettres de recommandation de ses protecteurs, il voyageait à peu de frais et recevait partout un accueil favorable. » Entendons par là que Froissart ne fréquentait sans doute pas les auberges, très peu nombreuses sur le territoire et considérées comme des coupe-gorges. Comme la plupart des voyageurs de l’époque, il devait loger chez des particuliers, « un parent, un ami, un confrère, un contact, voire un inconnu », c’était l’usage d’héberger les pèlerins et les “étrangers“.

Une solution pratique était de dormir chez l'habitant
(image extraite de Nota Bene sur Youtube)
Mais surtout, étant donné le nombre de dangers rencontrés, le voyageur ne se déplace jamais seul. Lorsque Froissart se rend quelque part, c’est parce qu’il suit le déplacement d’un roi, d’une cour, ou parce qu’il accompagne un chevalier dans un but précis. Au Moyen Age, le voyageur se doit d’être opportuniste.
C’est ainsi que, en 1365, « Froissart séjourna plusieurs mois en Ecosse auprès du roi David II Bruce (1324-1371) et l’accompagna dans son circuit à travers le pays, » écrit Jean Trotin qui donne le détail des trajets :
Froissart profite de ce voyage pour “interviewer“ le comte de Douglas « chez qui il demeura quinze jours au château de Dalkeith, à cinq lieues d’Edimbourg. Au retour, il passa par Carlisle. » (Longueur totale du trajet : environ 640 kilomètres).

"David II, roi d'Ecosse, reconnaît Edouard III, roi d'Angleterre, comme son suzerain féodal"
(image extraite de Wikipedia, Chroniques de Jean Froissart)
A Pâques 1366, il embarque à Sandwich (Angleterre) pour se rendre à Bruxelles, où il réside « dans le luxueux palais de Coudenberg, à la cour de son futur protecteur Wenceslas de Luxembourg (1337-1383), duc de Brabant ». A la fin de la même année il partit pour Bordeaux dans la suite du Prince de Galles (le « Prince Noir ») qui se rendait en Espagne pour y guerroyer contre un allié des Français, en passant par Nantes et La Rochelle. Il assiste au baptême du fils du Prince le 6 janvier 1367 à Bordeaux, ville que le Prince quitte en février 1367. Froissart l’accompagne jusqu’à Dax où, raconte Jean Trotin, « il reçut l’ordre de rentrer en Angleterre ».

Edouard III accorde la Guyenne à son fils le Prince Noir en 1362
(image extraite de Wikipedia)
 |
| Lionel d'Anvers, duc de Clarence (1338-1368) (image extraite du site unofficialroyalty.com) |
En avril 1368, il fait partie de la suite du duc de Clarence, fils cadet d’Edouard III, qui se rend à Milan pour s’y marier. Le roi de France Charles V accueillit tout ce petit monde à Paris du 16 au 20 avril. Puis le comte Amédée VI de Savoie les reçut dans ses résidences de Bourg-en-Bresse et de Chambéry, avant de les accompagner jusqu’à Milan. (Paris-Milan : 855 kilomètres)
Poursuivant son chemin, Froissart se rendit à Bologne, à Ferrare, et enfin à Rome, mais « la ville éternelle, alors à l’état d’abandon, le laissa apparemment indifférent, » regrette Jean Trotin. On ignore son itinéraire de retour. On sait qu’il était à Bruxelles lorsqu’il apprit la mort de la reine Philippa, le 15 août 1369, une nouvelle qui l’affecta beaucoup.
Il faut garder à l’esprit qu’au cours de tous ces déplacements, Froissart rencontre les grands de ce monde, ceux qui ont écrit l’Histoire avec leurs armées au long d’incessantes guerres. Ses notes s’amoncelant, fin 1369 Froissart commence la rédaction du premier livre de ses Chroniques, à la demande de Robert de Namur (1320-1392), ancien combattant de Calais en 1346 et veuf d’une sœur de Philippa. Son nouveau protecteur est Wenceslas de Luxembourg (chez qui, souvenez-vous, il a logé en 1366), pour qui il écrit son roman Meliador. « Sans doute ordonné prêtre à son retour d’Angleterre, poursuit Jean Trotin, Froissart devint en 1373, grâce à Wenceslas, curé d’Estinnes-au-Mont, près de Binches, jusqu’en 1384. » Selon A. Fourrier, cité par J. Trotin, « cette cure comptait parmi les dix plus importantes de cette circonscription du diocèse de Cambrai et rapportait à son titulaire un revenu de quarante livres tournois. »

Wenceslas de Luxembourg (1337-1383)
(image extraite de Wikipedia)
Le 4 novembre 1380, il accompagne Wenceslas à Reims pour assister au sacre de Charles VI (Bruxelles-Reims : 195 kilomètres). Mais son protecteur, atteint de la peste, meurt le 8 décembre 1383.
Froissart bénéficia alors de la protection de Guy de Châtillon (1346-1397), seigneur de Chimay et de Beaumont, comte de Blois, qui avait épousé une nièce de Robert de Namur et était lui-même un petit-fils de Jean de Hainaut, le premier protecteur de l’écrivain. Froissart abandonne la cure d’Estinnes et devient chapelain de Beaumont, trésorier du chapitre de Sainte-Monegonde (Chimay), au diocèse de Liège. Durant l’hiver 1385 il se rend à Cambrai pour assister à divers mariages, en mars 1386 il assiste à Blois aux fiançailles du fils de son protecteur, et à son mariage en août à Bourges. Il rentre avec le duc de Berry, amateur d’art, mécène (les Très Riches Heures du Duc de Berry, c’est lui) et accessoirement père de la mariée. Il passe peut-être par Valenciennes (tente Jean Trotin sans grande conviction), se rend à L’Ecluse puis, en 1387, à Gand.

Jean de France, duc de Berry (1340-1416)
(image extraite du site bourges-cathedrale.fr)
Et nous voici en 1388, une année à marquer d’une pierre blanche dans la succession des voyages de Froissart. Il a alors 50 ou 51 ans et vient d’achever le deuxième livre de ses Chroniques. Il s’ennuie un peu dans les Flandres, où la paix règne trop tranquillement à son goût. Il voudrait se rendre dans le sud et rencontrer le comte de Foix, le célèbre Gaston Fébus (1331-1391), pour lui faire raconter ses faits d’armes et entendre les chevaliers du sud apporter leurs connaissances sur les guerres méridionales.

Gaston Fébus à la chasse
(image extraite de Wikipedia)
Après avoir baguenaudé le long de la Loire à la suite de son protecteur (Blois, Château-Renault, Angers…), il obtient de Guy de Châtillon son congé et des lettres de recommandation pour le comte de Foix. Le voyage et le séjour vont durer cinq mois et donner lieu à la rédaction du Livre III des Chroniques, un récit qui régale encore aujourd’hui tous les curieux de l’art de vivre au Moyen Age.

Itinéraire de Froissart, de Carcassonne à Orthez en 1388.
Carte dressée par Claudie Arin dans son livre
"Voyage dans les Pyrénées à la rencontre de Fébus"
La première mission de Froissart est d’aller chercher près de Montpellier quatre lévriers (nommés Brun, Roland, Hector et Tristan), cadeau du comte de Blois au comte de Foix car le lévrier est alors l’animal préféré des grands de ce monde. Il traverse donc le Berry, l’Auvergne, atteint le Languedoc puis rejoint Carcassonne. Bizarrement, aucune indication n’est donnée sur qui l’accompagne dans cette longue traversée. Plus tard, Froissart parti de Carcassonne et arrivé à Pamiers, avoue : « Je m’y arrêtais quelque temps (à Pamiers), en espérant rencontrer quelqu’un qui irait en pays de Béarn où résidait le comte de Foix, et qui pourrait m’y accompagner, » car, précise-t-il, « j’hésitais quelque peu sur la route à prendre. » Souvenez-vous, au Moyen Age, pour bien des raisons, on ne voyage pas seul. Froissart a de la chance : « Alors que j’étais depuis trois jours dans cette ville (à Pamiers), se présenta par hasard devant moi un chevalier du comte de Foix qui revenait d’Avignon. Il s’agissait d’un homme nommé Espaing du Lyon, vaillant et sage, et très beau chevalier, qui devait avoir cinquante ans. Je me mis en sa compagnie, et il en fut très heureux, pour connaître grâce à moi les nouvelles de France. Nous fîmes ainsi dix jours de route ensemble pour arriver à Orthez. »
De ville en ville et de lieue en lieue, les deux compagnons déjeunent et logent dans des châteaux appartenant à Gaston Fébus – chaque étape étant l’occasion de raconter une anecdote édifiante sur l’histoire des lieux. Les récits d’assauts, d’escarmouches, de pillages, de prises d’otages, de rançonnages, se succèdent, à cheval entre les deux hommes, puis sous la plume de Froissart.
L’écrivain partage aussi ses effrois : « Nous pensions passer le pont sur la Garonne […] mais nous ne pûmes car la veille il était tombé des pluies diluviennes qui avaient mis en crue une autre rivière […] Elle avait tant grossi qu’elle avait gonflé les eaux de la Garonne à tel point qu’une grosse arche du pont de bois n’avait pas résisté et s’était rompue. […] Le lendemain le chevalier décida de passer la rivière en bateau. […] Nous avons fini par pouvoir passer de l’autre côté avec nos chevaux. Mais je vous assure que nous avons traversé la Garonne à grand peine et à grand péril. Le bateau qui nous a fait passer n’était pas très grand, et il ne pouvait y entrer que deux chevaux à la fois avec ceux qui les tenaient et les hommes qui conduisaient le bateau. »

Les voyages en bateau étaient encore plus dangereux que les voyages à cheval
(image extraite de Nota Bene sur Youtube)
La sérénité retrouvée, les récits de batailles et de combats reprennent. « Les récits d’Espaing du Lyon me divertissaient beaucoup, avoue Froissart, je les écoutais avec un immense plaisir, et du coup le voyage me paraissait bien plus court. » Mais il n’oublie pas pourquoi il est venu : « dès que nous descendions dans une auberge (qui ont fini par succéder aux châteaux), tout au long de la route que nous avons faite ensemble, je les notais par écrit (les récits) pour en avoir un meilleur souvenir plus tard. Car pour garder un souvenir exact des choses, il n’y a rien de tel que de le mettre par écrit. »
Enfin les deux compères arrivent à Orthez, « au moment du soleil couchant ». Froissart descend « à l’auberge de la Lune, chez un écuyer du comte, Ernauton du Pin, qui me reçut avec joie parce que j’étais Français. » En pleine nuit Gaston Fébus le fait appeler : « Quand il me vit il me fit bon accueil et me retint en son hôtel, où je suis resté plus de douze semaines, mes chevaux bien nourris, et pris en charge pour tout le reste. » Et c’est pour entendre ses poésies, toujours, que le comte retient l’écrivain, notamment Meliador dont il lui fait la lecture.

Froissart rencontre Gaston Fébus à Orthez
(image extraite de Wikipedia, Chroniques de Jean Froissart)
Riche de mille histoires et renseignements historiques, Froissart quitte Orthez début mars 1389, avec une délégation qui part pour Avignon. Elle accompagne Jeanne de Boulogne rencontrer le pape Clément VII avant de la conduire à son futur époux, Jean duc de Berry (oui, nous avons déjà croisé ce duc en 1386, au mariage de sa fille). C’est à nouveau Jean Trotin qui raconte : « On passa par Tarbes, Toulouse et Villeneuve-les-Avignon, » où Froissart arriva le 21 mai. Il parvint à Orange et, par Lyon et la région du Forez, arriva à Riom où le mariage fut célébré le 6 juin 1389. Il remonta à Paris avec le premier chambellan de Charles VI, et assista le 22 août à l’entrée solennelle d’Isabeau de Bavière et aux fêtes données en son honneur.
Après trois jours à Crèvecoeur-sur-Escaut, puis quinze jours à Valenciennes, Froissart rejoint Guy de Blois à Schoonhoven en Hollande, avant de revenir à Valenciennes en 1390 pour rédiger son fameux Livre III des Chroniques. Le quatrième Livre suivra de 1390 à 1400.
Juin 1793 : Froissart est à Abbeville ; 1394 : il est à Valenciennes ; juillet 1395 : dernier voyage en Angleterre.
Un an plus tard il se trouve à Saint-Omer, puis se retire, semble-t-il, à l’abbaye de Cantimpré, aux portes de Cambrai. La date et le lieu de sa mort ne sont pas connus. On a coutume de parler de Chimay, et d’une date entre 1404 et 1410. Je n’ai pas d’opinion sur la question.
Son portrait non plus, n’est pas très connu. On pense que le plus “véridique“ est celui de Jacques de Boucq, gardé à la Bibliothèque d’Arras, sur lequel Froissart aurait environ 60 ans :
Une miniature figurant dans ses Chroniques le représente travaillant à sa table « dans sa forge » comme il dit :

(image extraite de Wikipedia, Chroniques de Jean Froissart)
Plus fantaisistes, existent aussi deux représentations du poète pleines de romantisme :

(image extraite du livre "Archives historiques et littéraires du nord de la France
et du midi de la Belgique" d'Arthur Dinaux)
 |
| (image Association Philatélique Senlisienne) |
A Valenciennes, Henri Lemaire s’est plutôt rapproché du portrait d’Arras pour sa statue inaugurée en 1856 :

Le Monument à Froissart, à Valenciennes
(photo personnelle)
Pour autant, aucune de ces représentations ne rend hommage à la conscience professionnelle de notre écrivain : les milliers de kilomètres qu’il a parcourus à dos de cheval pour interviewer ses contemporains auraient dû lui valoir une statue équestre, vous ne trouvez pas ?
________________________
Mes sources :
« Vie et Œuvre de Jean Froissart » par Jean Trotin in Valentiana n°4, décembre 1989.
Jean Froissart, Voyage dans les Pyrénées à la rencontre de Fébus par Claudie Arin, 2006.
« Comment voyage-t-on au Moyen Age ? » et « Pourquoi voyage-t-on au Moyen Age ? » par Nota Bene sur Youtube.